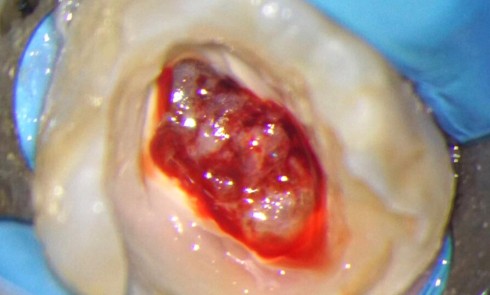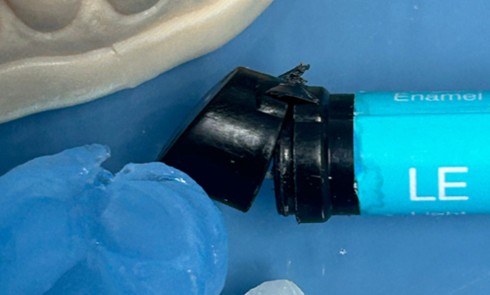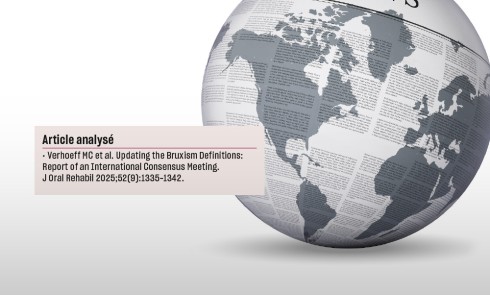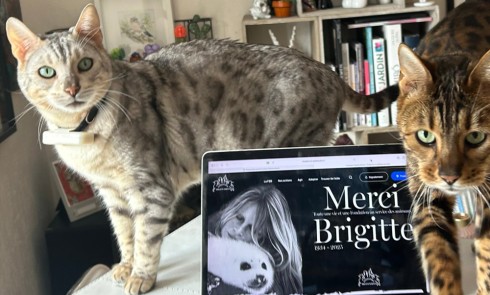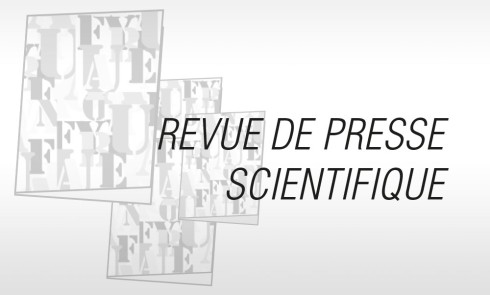Les chirurgies orales supposent la réalisation d’une anesthésie préalable pour supprimer la douleur perçue par le patient. L’obtention du silence opératoire permet ainsi l’accomplissement d’un acte invasif de manière sereine et confortable pour le praticien comme pour son patient. Cependant, les auteurs de l’étude rapportée rappellent que chez les enfants, la perspective de recevoir une anesthésie est communément associée à l’idée de douleur. Leur niveau d’anxiété s’en trouve considérablement augmenté avec en corollaire une attitude de défiance ou même de défense vis-à-vis des actes dentaires à réaliser. Différentes méthodes de distractions sans recours à des substances pharmacologiques visent à détourner l’attention des enfants ou des jeunes adolescents au moment de l’injection de l’anesthésie vers quelque chose de positivement attractif pour entraver les mécanismes psychologiques de perception de la douleur ainsi que leur niveau d’anxiété.
Les auteurs distinguent deux types de distractions : actives et passives. Les formes de distractions actives impliquent un engagement dans une activité annexe pendant la procédure thérapeutique anxiogène, tandis que les distractions passives impliquent l’observation ou la perception d’un stimulus audio et/ou visuel pour accaparer leur attention et l’isoler de l’environnement clinique. L’étude conduite dans cet article vise à comparer, pendant la réalisation d’une anesthésie tronculaire, les effets de deux techniques distractives, active et passive, par rapport à l’absence de distraction supplémentaire tenue comme témoin.
123 enfants âgés de 8 à 12 ans, patients du service d’ontologie pédiatrique d’un même centre hospitalo-universitaire indien entre mai 2019 et mai 2021, ont été répartis de manière randomisée en trois groupes de 41 sujets traités par le même opérateur. Dans le premier groupe, il a été demandé aux enfants…