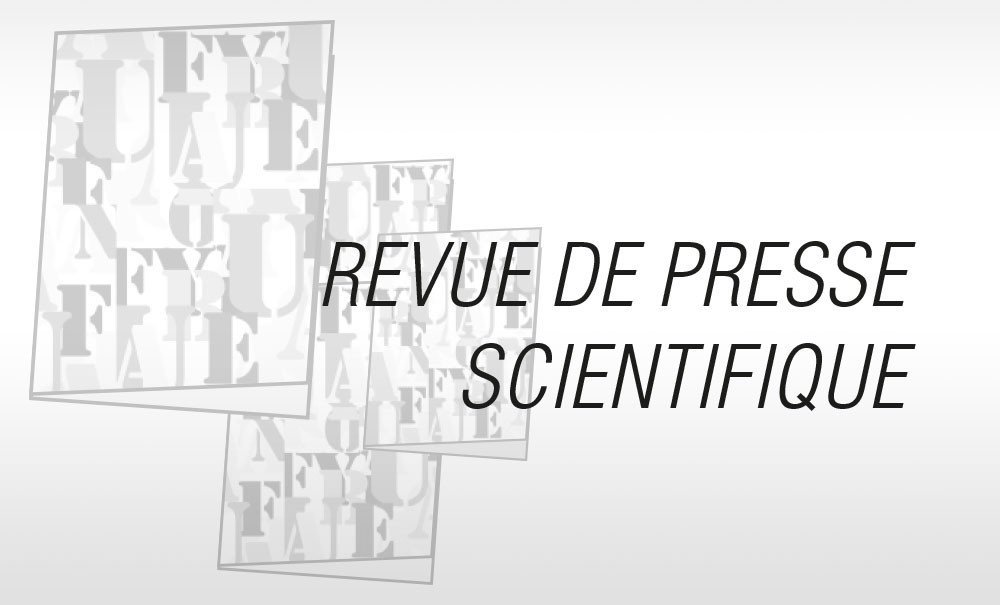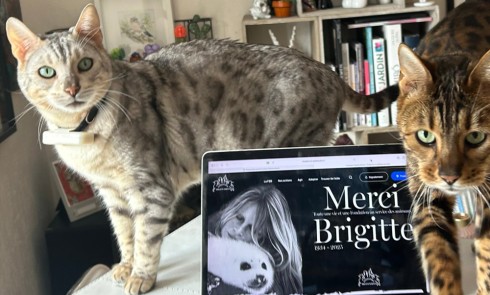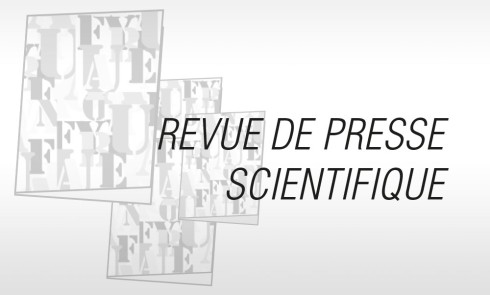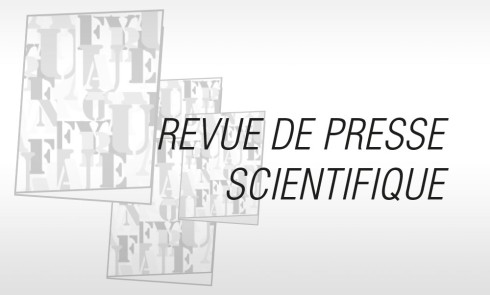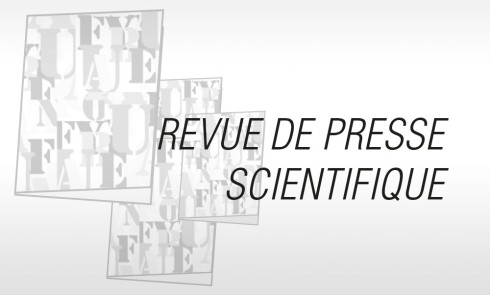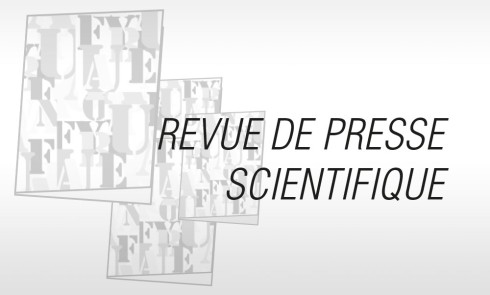Introduction : Une supraclusion caractérisée par un recouvrement vertical excessif des incisives maxillaires et mandibulaires d’au moins 40 % de la hauteur de la couronne clinique des incisives mandibulaires, peut être l’indication d’un traitement précoce pendant la croissance pour tirer parti de l’adaptation des muscles masticateurs. Un plan de morsure antérieur amovible (PMAA) est couramment utilisé à cette fin, facilitant l’extrusion des dents postérieures mandibulaires et, dans une moindre mesure, la vestibuloversion des incisives mandibulaires.
Objectifs : Comparer l’efficacité de deux protocoles de correction de l’occlusion profonde chez des patients en croissance utilisant un plan de morsure antérieur amovible (PMAA) : port permanent avec appareil en place pendant les repas (P + R) vs hors des repas (P – R) et explorer la relation entre la durée moyenne quotidienne de port et le taux de correction de la supraclusion (SC), stratifiée par protocole de port.
Matériels et méthodes : Trente-deux patients en croissance présentant une occlusion profonde (âge moyen = 10,94 ± 2,17 ans) ont été répartis de manière aléatoire dans le groupe F + M (n = 16) ou F – M (n = 16). Des téléradiographies ont été réalisées au départ (T0) et lorsque la SC normale a été atteinte (T1). La durée de port a été enregistrée par un microcapteur TheraMon situé à l’intérieur de l’appareil. Un modèle de régression best-fit a été déterminé pour la relation entre la durée quotidienne de port et le taux de correction de la SC (α = 0,05).
Résultats : Les deux groupes présentaient des caractéristiques de base et des modifications céphalométriques similaires, à savoir une extrusion molaire et une intrusion et une vestibuloversion incisives dans les deux arcades (P < 0,05), et les différences entre les groupes n’étaient pas significatives. Ici, F + M a présenté des taux significativement plus rapides de correction…