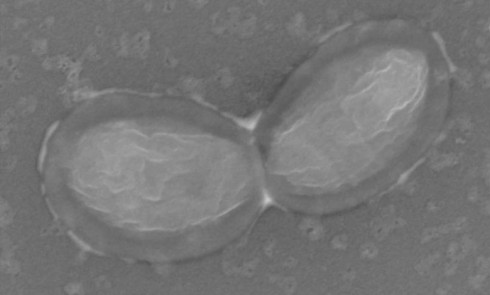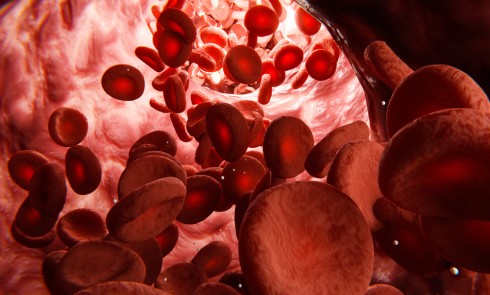Qu’est-ce que l’addiction ?
L’addiction peut être définie comme une perte de contrôle de l’usage d’une activité, d’un bien ou d’une substance. La recherche compulsive et la consommation malgré les conséquences néfastes peuvent en être une autre signification [1]. Le terme « dépendance » comprend deux composantes, physique et comportementale. L’addiction, elle, est souvent associée au volet uniquement comportemental. La cinquième édition du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) décrit le diagnostic d’une addiction à une substance par un modèle de signes cliniques reliés à la dépendance, mais également par quatre critères principaux : A, le développement d’un syndrome spécifique à la consommation de la substance ou de l’activité ; B, des changements attribuables aux effets de la substance/activité sur le système nerveux central (SNC) ; C, le syndrome entraîne une déficience dans des situations sociales, professionnelles ou autres ; D, les symptômes ne sont pas attribuables à une autre pathologie.
La dépendance comprend plusieurs notions intrinsèques :
- la tolérance, qui représente la nécessité d’augmenter l’usage de l’activité pour retrouver une réponse similaire à la première utilisation [2] ;
- le besoin intense de consommation d’une substance ou d’un comportement non vital (craving) [3] ;
- le sevrage, qui illustre la tentative d’arrêt d’une conduite addictive, et qui peut entraîner des symptômes [4].
Toutes ces notions s’expliquent par des mécanismes neurologiques liés au circuit cérébral de la récompense qui est formé de trois connexions synaptiques avec comme neurotransmetteurs le GABA, le glutamate et la dopamine [5]. Une grande partie des neurones produisant cette dernière ont le corps situé au niveau de l’aire tegmentale ventrale. La dopamine agit, entre autres, au niveau du noyau accumbens, ce qui provoque une sensation de bien-être…