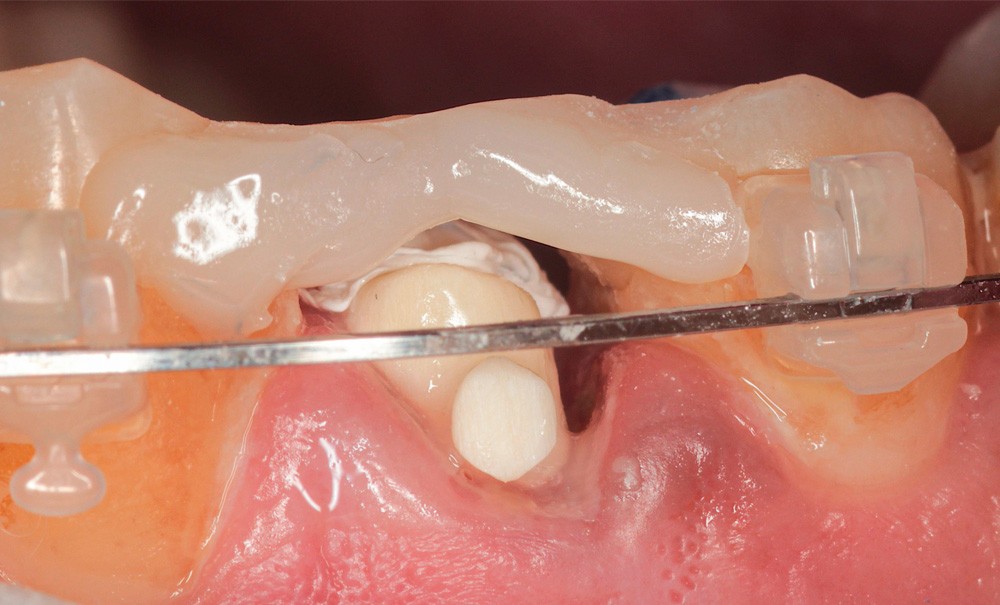Il semble clairement aujourd’hui, au vu des statistiques de la maladie péri-implantaire (19,53 % des patients et 12,5 % des implants sur une période de suivi supérieure à 9 ans) [1, 2], que le traitement implantaire n’est pas dénué de risques. Une méta-analyse récente [3] rapporte une prévalence moyenne de mucosite de 63 % (CI: 57,6–68,2 %) au niveau des patients et de 59,2 % (CI: 55,8-62,4 %) au niveau des implants. Les péri-implantites sont observées chez 25 % (CI: 21,1-29,3 %) des patients et dans 18 % (CI: 15,8-20,5 %) des implants (les études sélectionnées incluent des implants avec un temps moyen de mise en fonction allant de 3 ans à 13 ans environ).
Si on ajoute que le traitement des pathologies péri-implantaires n’est pas toujours un traitement facile, il paraît évident que plus on prolonge les dents, plus cela est bénéfique pour le patient (dans un contexte où le bilan médical le permet), et donc que la sauvegarde de la dent doit rester l’objectif prioritaire de nos traitements en tant que chirurgien-dentiste [4]. Cependant, déterminer si l’on peut conserver une dent demande de pouvoir établir un diagnostic précis et un pronostic fiable. Or, en chirurgie dentaire, il est souvent difficile de pouvoir donner un pronostic « sûr à 100 % » sur une dent [5]. De plus, à côté des facteurs cliniques permettant de poser l’indication de la réalisation d’une prothèse dentaire, il faut aussi prendre en considération les paramètres économiques et ceux en relation directe avec le patient. L’implication de ce dernier (motivation, finances), mais aussi son état de santé et son âge, sont évidemment à prendre en compte dans ces décisions d’extraction ou conservation [6], même si l’âge semble être un paramètre moins important que l’état de santé, et notamment les risques infectieux généraux. Différents paramètres doivent donc être évalués pour une prise de décision raisonnée.