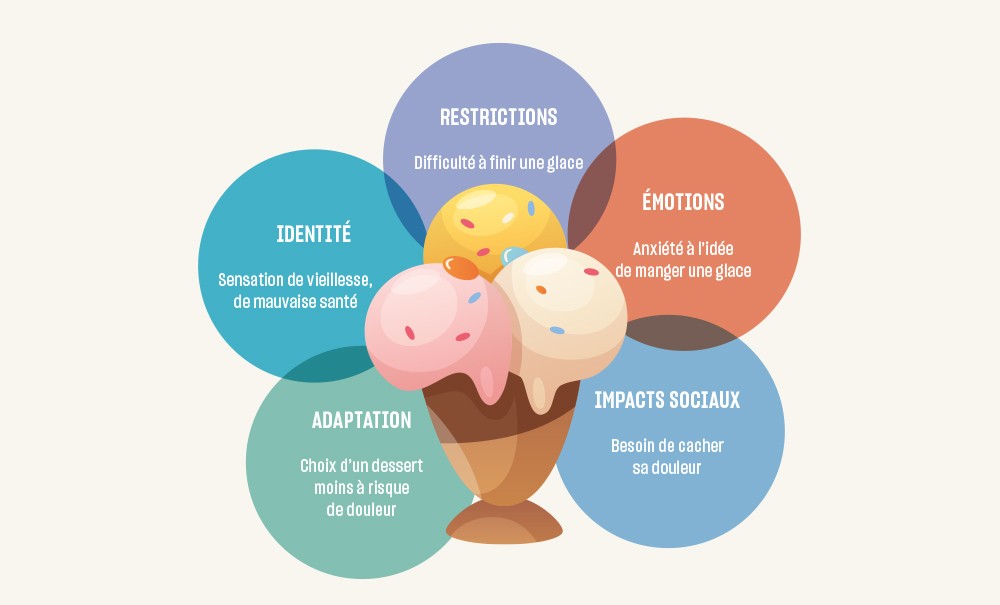Épidémiologie
Les données épidémiologiques concernant l’hypersensibilité dentinaire (HD) et sa prévalence sont extrêmement hétérogènes. Dans l’article le plus récent sur le sujet, Favaro Zeola et ses collaborateurs rapportent des chiffres variant de 1,3 % (Nigeria) à 92,1 % (Royaume-Uni) [1]. En ce qui concerne la sensibilité au test du jet d’air froid, les valeurs oscillent entre 29,7 % en Finlande et 47,9 % en Italie, avec une moyenne de 41,9 % en Europe et de 39,6 % en France [2]. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces variations, tels que la nature de la population étudiée, les méthodes diagnostiques utilisées, ainsi que les habitudes culturelles et alimentaires spécifiques à chaque pays. Par exemple, chez les patients recrutés dans des consultations spécialisées en parodontologie ou ayant des antécédents de soins parodontaux, la prévalence sera généralement plus élevée que dans la population générale [3]. Il apparaît que l’HD est plus fréquente chez les adultes jeunes d’âge moyen (20-50 ans) et tend à diminuer avec l’âge, notamment en raison de la formation de dentine secondaire qui se produit naturellement au fil du temps.
Physiopathologie, diagnostic et qualité de vie
Les termes « hypersensibilité » et « hyperesthésie » sont parfois utilisés de manière interchangeable pour décrire un même tableau clinique. L’hypersensibilité, au sens propre, désigne une réactivité émotionnelle et sensorielle accrue, caractérisée par un seuil de perception diminué (seuil affaibli). En revanche, l’hyperesthésie se réfère à une sensibilité excessive aux stimulations sensorielles, entraînant une réponse exacerbée.
Les théories actuelles suggèrent que ces deux concepts peuvent être pertinents, car plusieurs mécanismes physiopathologiques pourraient être impliqués : certains soutiennent l’idée d’une hypersensibilité, tandis que d’autres évoquent une hyperesthésie.