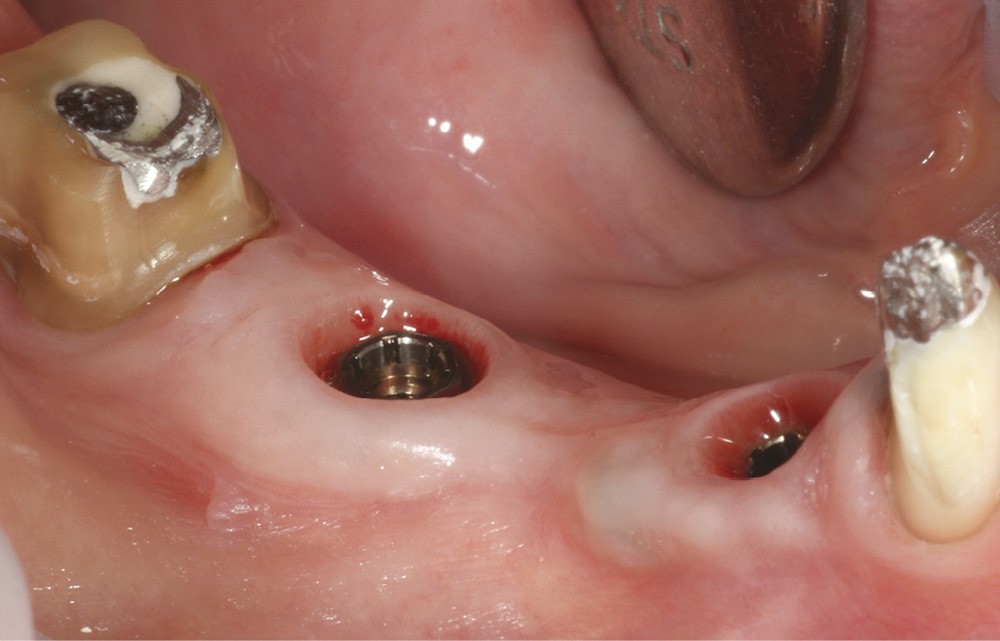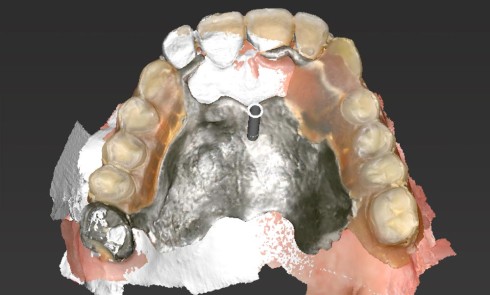L’ostéointégration, bien maîtrisée à l’heure actuelle, ne constitue plus le seul critère définissant un « succès implantaire ». En effet, s’y ajoute la recherche d’une restauration prothétique intégrée au contexte gingivo-dentaire environnant, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Cela suppose tout d’abord une préservation maximale, voire une reconstruction, des tissus ostéo-muqueux péri-implantaires [1] ; puis, une approche prothétique adéquate. La littérature récente montre que les restaurations implantoportées fixées présentent une bonne longévité, celle-ci concernant aussi bien l’implant que la suprastructure, qu’elle soit unitaire ou plurale [2-4]. Le succès à court terme est grandement conditionné par la gestion de la zone transmuqueuse, qui doit à la fois mimer au mieux l’émergence naturelle de la dent pour assurer la persistance des papilles, mais aussi favoriser un environnement nettoyable et peu propice au développement du biofilm bactérien. À moyen et long terme, les aspects occlusaux, de même que les aspects mécaniques liés aux matériaux ou à l’assemblage deviennent prépondérants. Ainsi, le mode de connexion entre l’implant et la restauration prothétique sus-jacente (pilier ou couronne transvissée) impacte non seulement la stabilité de l’assemblage, mais aussi celle des tissus naturels environnants. Cet article se propose de faire le point sur les formes de connexions prothétiques existantes et sur l’impact de ces choix sur les plans biologiques et biomécaniques.
Formes et situations des connexions implantaires
Les édifices implantaires comprennent tous une connexion entre l’implant lui-même, et l’(es) élément(s) prothétique(s). La forme et le positionnement spatial de l’implant au niveau de cette jonction (prothèse/implant) définissent le type de la connexion.
Schématiquement, la forme de la connexion implantaire peut soit émerger de l’implant, constituant…