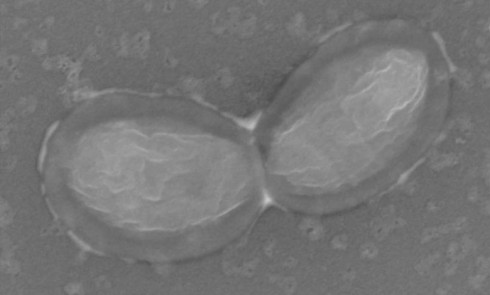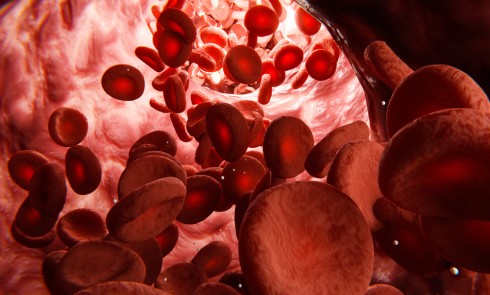Parmi les complications rencontrées en implantologie, le taux de mucosite atteindrait 43 % des patients, et le taux de péri-implantites s’établirait à 22 % [2]. Elles concernent un grand nombre de patients [3]. Les récessions péri-implantaires, qu’elles soient associées ou non à une péri-implantite [4], représentent également une complication biologique, dont la prévalence serait de 16,9 % [5]. Enfin, des complications mécaniques, comme des fractures de vis ou de suprastructure, ou des dévissages d’éléments prothétiques [6] peuvent aussi exister.
Toutes ces complications peuvent aboutir à la dépose de l’implant, ou explantation, et posent à ce titre un challenge pour les cliniciens : la décision de conserver un implant ou non est aujourd’hui basée sur des opinions d’expert et sur le sens clinique de chaque praticien [7]. Pour évaluer la conservabilité d’un implant pathologique, le clinicien évalue d’abord son pronostic, c’est-à-dire la prédiction de l’issue de la maladie [8]. Or, les modèles de pronostic de traitement des complications implantaires sont rares, et la question bénéficie encore à ce jour de peu de travaux. Le but de cette revue de littérature est d’identifier les modèles existants, et de proposer un arbre décisionnel pour l’explantation ou la conservation des implants.
Matériel et méthode
Une revue de littérature a été menée dans le cadre d’une thèse d’exercice à l’université Paris Cité [9]. Une question « PICO » a été construite, avec des patients souffrant de pathologies péri-implantaires comme population (P), l’explantation comme intervention (I), la conservation comme comparaison (C) et la profondeur de sondage, le saignement au sondage et la perte osseuse marginale comme résultats (O). Une équation de recherche PubMed issue de cette question a permis d’identifier 46 articles. Les recherches ont été complétées par les bibliographies des articles sélectionnés…