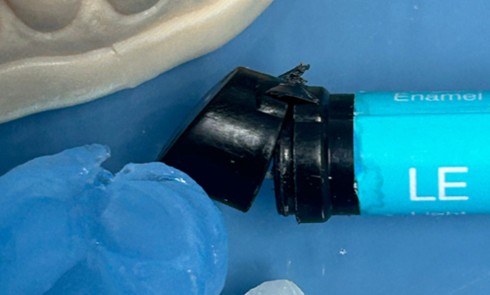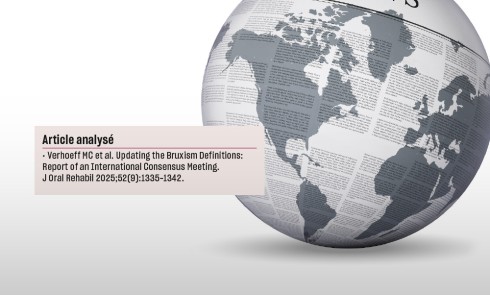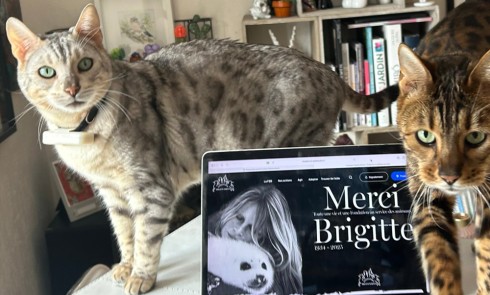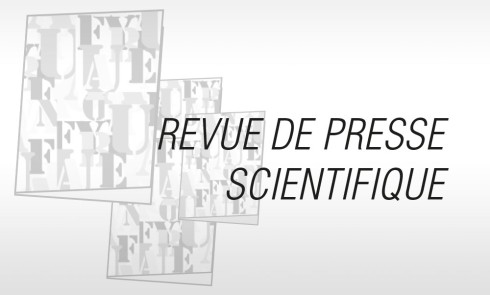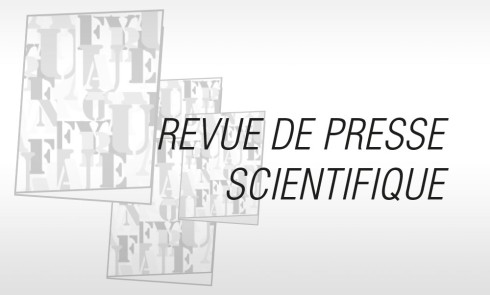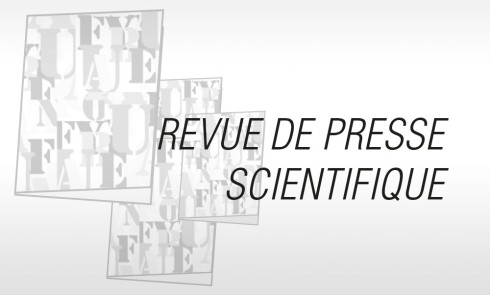Parmi les différentes causes de l’usure dentaire, l’attrition (usure par frottement des dents les unes contre les autres) résultant du bruxisme est sans doute la plus largement connue, bien que certains de ses aspects restent mystérieux. Le Collège National d’Occlusodontie (CNO) définit le bruxisme comme un comportement qui se caractérise par une activité motrice involontaire des muscles manducateurs, continue (serrement) ou rythmique (grincement), avec contacts occlusaux. Il est classiquement décrit comme une parafonction, c’est-à-dire un ensemble d’activités coordonnées ne concourant pas à une finalité fonctionnelle. Toutefois, ses mécanismes n’étant pas complètement connus ou compris, il semble que même s’il ne participe pas à l’une des fonctions manducatrices (élocution, expression, mastication), il pourrait jouer un rôle plus ou moins important sur l’équilibre psychologique du patient, en ce sens qu’il lui permettrait une certaine gestion du stress.
Bien que les conséquences de l’attrition sur les dents soient hautement dommageables, le bruxisme ne constitue pas forcément un trouble ou une pathologie. D’ailleurs, généré par des mécanismes nerveux centraux inconscients, on ne traite pas le bruxisme avec l’ambition de l’annihiler, mais plutôt d’en diminuer les effets nocifs sur les structures (dents, muscles, articulations) par un traitement symptomatique (orthèse) ou en essayant d’en diminuer la prévalence (thérapies comportementales de prise de conscience), en particulier pour le bruxisme diurne. Mais le bruxisme nocturne, qui représente plus de 80 % du phénomène, demeure le plus difficile à gérer. Faut-il cependant le considérer comme un trouble du sommeil ?
La médecine du sommeil, qui s’est considérablement développée cette dernière décennie, prête une plus grande attention à la qualité du sommeil et à son importance sur la santé générale. Au-delà des risques cardiovasculaires…