Par Hélène Rangé et Olivier Huck
Les antibiotiques sont aujourd’hui indiqués dans des cas très limités en parodontologie et en implantologie. Les antibiotiques locaux n’ayant pas fait la preuve de leur efficacité, seule l’administration systémique peut être indiquée pour prévenir le risque infectieux (antibioprophylaxie) ou améliorer les résultats du traitement (antibiothérapie adjuvante). Les effets secondaires digestifs des antibiotiques comme l’amoxicilline et le métronidazole sont fréquents. La prescription concomitante de Saccharomyces boulardii CNCM I-745, une levure, est recommandée.
Les recommandations 2024 du Collège National des Enseignants en Parodontologie (CNEP) et de la Société Française de Parodontologie et Implantologie Orale (SFPIO) ont proposé, afin d’optimiser l’action des antibiotiques systémiques et de limiter les résistances bactériennes, des règles de prescription basées sur les dernières classifications et études scientifiques.
En parodontologie, la prescription d’antibiotiques n’est pas recommandée pour le traitement des abcès parodontaux sans symptômes généraux, des lésions endo-parodontales ainsi que de la majeure partie des parodontites.
En revanche, leur prescription est indiquée dans le traitement de première intention des maladies parodontales nécrosantes et doit permettre d’améliorer la réponse au traitement dans les parodontites sévères (stades III-IV) associées à des facteurs aggravants (début précoce, distribution molaire-incisive). Le protocole préconisé est alors : amoxicilline 500 mg + métronidazole 500 mg, 3 fois par jour, pendant 7 jours chez les patients ne présentant pas d’allergie. Pour les actes chirurgicaux (assainissement, régénération), les antibiotiques ne sont pas systématiques, mais peuvent être prescrits selon la complexité de l’acte et le profil du patient. Chez les patients diabétiques, une antibioprophylaxie est envisagée seulement si le taux d’HbA1c dépasse 8 %. L’avis du médecin traitant est utile pour les patients présentant des complications liées à l’hyperglycémie chronique ou présentant des difficultés dans l’équilibration de leur diabète. Les patients immunodéprimés nécessitent une évaluation spécifique en accord avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) de 2011 et 2024.
De même, il est également important de rappeler les recommandations relatives à la prévention de l’endocardite infectieuse. Chez les patients à risque d’endocardite infectieuse, le sondage parodontal, le traitement parodontal (détartrage et instrumentation sous-gingivale), ainsi que les interventions chirurgicales telles que la gingivectomie, l’élongation coronaire, le traitement chirurgical des poches avec ou sans comblement mais sans utilisation d’une membrane de régénération osseuse sont autorisés sous antibioprophylaxie (HAS, 2022).
En implantologie, l’antibioprophylaxie est suggérée pour limiter les échecs précoces chez les patients à risque (chirurgie longue, implants multiples, immunodépression). Pour les chirurgies d’augmentation osseuse, un traitement postopératoire par amoxicilline (2 g par jour pendant 7 jours) est possible. Dans le traitement des maladies péri-implantaires, l’antibiothérapie systémique n’est pas recommandée de façon systématique. Elle peut être envisagée selon la complexité du cas, notamment lorsqu’une thérapeutique de régénération est envisagée. La mise en place d’implants sans utilisation d’une membrane de régénération osseuse, la mise en place de piliers implantaires de cicatrisation en cas d’implants enfouis, de chirurgie pré-implantaire sans utilisation d’une membrane de régénération osseuse sont possibles chez le patient à risque d’endocardite infectieuse sous antibioprophylaxie (HAS, 2022).
Il est utile de rappeler que la prescription d’antibiotiques ne peut se substituer aux mesures antiseptiques classiques et doit s’accompagner de tous les moyens disponibles pour améliorer le contrôle de plaque du patient. Un bain de bouche antiseptique (chlorhexidine à 0,2% ou 0,12% avant un soin parodontal ou implantaire) est efficace pour réduire la charge bactérienne buccale et donc le risque de bactériémie associé.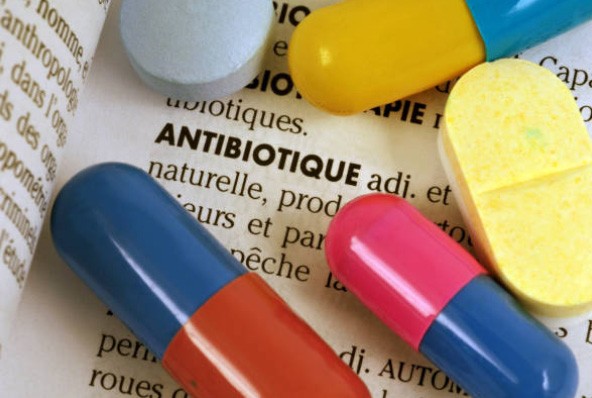
Enfin, une attention est portée à la prévention des effets secondaires des antibiotiques, notamment via l’usage de probiotiques. Les antibiotiques, bien qu’efficaces contre les infections bactériennes, perturbent significativement le microbiote intestinal, entraînant une dysbiose. Celle-ci se caractérise par la réduction de la diversité microbienne et la diminution des bactéries bénéfiques facilitant la prolifération de pathogènes opportunistes. Ces effets sont immédiats, responsables de diarrhée, et peuvent également persister plusieurs semaines, voire mois, et favoriser l’apparition de troubles chroniques (diabète, obésité, maladies inflammatoires, troubles digestifs ou neurologiques…).
Le microbiote intestinal, composé de milliards de micro-organismes, joue un rôle crucial dans la digestion, la protection contre les pathogènes, l’immunité et l’intégrité de la barrière intestinale. Or, il est particulièrement vulnérable aux antibiotiques. Dès les premières 24 heures de traitement, une chute de 30 % de la population bactérienne peut être observée. Pour limiter ces effets, l’usage de probiotiques est recommandé. Saccharomyces boulardii CNCM I-745 est une levure, donc naturellement résistante aux antibiotiques. À la différence des probiotiques bactériens, cette souche fongique :
- protège la diversité du microbiote ;
- réduit la prolifération des pathogènes opportunistes ;
- accélère le retour à un état d’équilibre après traitement.
Des études cliniques menées dans différentes pathologies ont démontré que la prise conjointe de Saccharomyces boulardii CNCM I-745 et d’antibiotiques préserve significativement le microbiote, réduisant les troubles digestifs associés (diarrhées, douleurs abdominales). Elle est également efficace dans les traitements d’éradication d’Helicobacter pylori (en réduisant de 56 % les effets indésirables) et de Clostridioides difficile (réduction du risque de récidive : 1,7 % de récidive dans le groupe test et de 13,1% de récidive dans le groupe contrôle) (Chitapanarux et al., Sci Rep, 2025).
Pour télécharger les recommandations CNEP/SFPIO 2024 : www.cneparo.fr
PU-PH
UFR Odontologie, Université de Rennes
CHU de Rennes
PU-PH
Université de Strasbourg
Faculté de chirurgie dentaire, Parodontologie
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, pôle de médecine et chirurgie bucco-dentaires









Commentaires