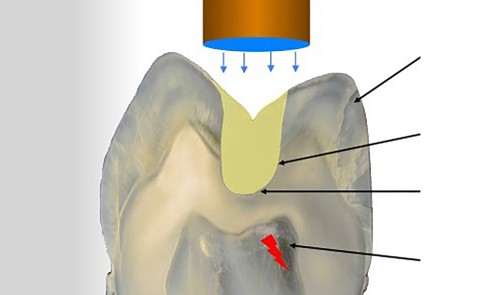Le choix d’un matériau de restauration directe constitue un réel challenge pour l’omnipraticien. L’amalgame, bien que matériau ancien (1), reste très utilisé en France (2). Suspecté d’effets toxiques liés au mercure, son usage est désormais réglementé en France chez la femme enceinte ou allaitante (3).
Par ailleurs, la plupart des résines composites contiennent du bisphénol A (BPA) de par leur composition en bis-GMA (4, 5). Or le BPA sera interdit dans les ustensiles, contenants et conditionnements alimentaires en 2014. Cette problématique fait dire au Pr M. Goldberg (6) que le BPA « libéré par les résines de reconstitution et de scellement, (il) s’avère de toute évidence être une molécule à risque.»
Ainsi, bousculés par les « principes de précaution sanitaire » et une demande croissante d’esthétique et de biocompatibilité, les choix des praticiens évoluent. En France, les Ciments Verre Ionomère (CVI) semblent avoir discrètement trouvé une place non négligeable dans les pratiques quotidiennes. En 2012, les composites représentaient, en valeur, 56 % des matériaux vendus en Europe ; les CVI 17 %, l’amalgame 5 %, et divers matériaux se partageaient le reste (7).
Cet article se propose d’exposer les raisons de cette réalité clinique et de préciser quand et comment recommander aujourd’hui les CVI pour réaliser des obturations pérennes sur une dent pulpée.
Les ciments Verre Ionomère : d’hier à aujourd’hui
Les premiers « ciment verre ionomère basse viscosité » (CVI-BV : Aspa®, Cermet®, ChemFil®, Fuji II®) furent lancés à partir de 1972 (8). Ils offraient adhésion, biocompatibilité et facilité de mise en œuvre. Ces indéniables qualités ne pouvaient toutefois pas compenser leur manque de dureté et de résistance à la flexion. En effet, leur réaction de prise était alors très influencée par l’environnement hydrique de la cavité buccale. Ainsi, les CVI étaient successivement…