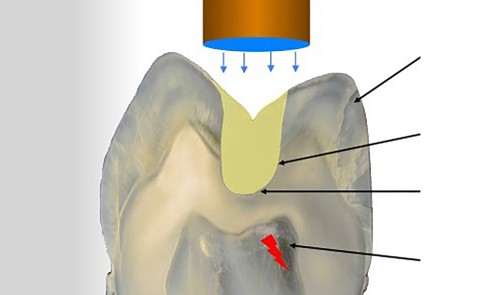Étymologiquement, le terme de céramique vient du grec Keramos qui signifie « terre à potier, ou argile ». Dans l’histoire de l’humanité, ce premier « art du feu » est apparu bien avant la métallurgie et le travail du verre. Il a même donné son nom au quartier des potiers à Athènes, « le Céramique ». Le mot céramique désigne classiquement l’ensemble des objets fabriqués à partir de terre (argile) qui ont subi une transformation physico-chimique irréversible au cours d’une cuisson à température plus ou moins élevée. On distingue ainsi, parmi les céramiques traditionnelles, les terres cuites (950 à 1 050 °C), les faïences (950 à 1 100 °C), les grès (1 000 à 1 300°) et les porcelaines qui présentent la plus faible porosité résiduelle (1 100 à 1 500 °C). En science des matériaux ou en chimie, on caractérise les céramiques comme des matériaux solides non métalliques et non organiques mais qui peuvent être composés d’atomes métalliques, non métalliques ou métalloïdes liés pas des liaisons chimiques fortes. ioniques ou covalente (NB : les polymères sont quant à eux des matériaux organiques). Les céramiques peuvent intégrer une grande variété de composants, dont les oxydes métalliques, les borures, carbures, nitrures, siliciures et les mélanges complexes de ces matériaux. La transformation des composants initiaux par l’action de fortes températures donne au produit fini des propriétés nouvelles concernant son aspect optique, sa solidité, sa résistance à l’usure, à la chaleur, ou encore des propriétés isolantes parmi bien d’autres.
C’est au départ pour ses propriétés optiques capables de ressembler aux dents naturelles, ses propriétés de résistance mécanique et chimique que des céramiques ont été employées pour la restauration des dents délabrées ou absentes. Les propriétés de biocompatibilité, d’adhésion cellulaire qui permettent une excellente…