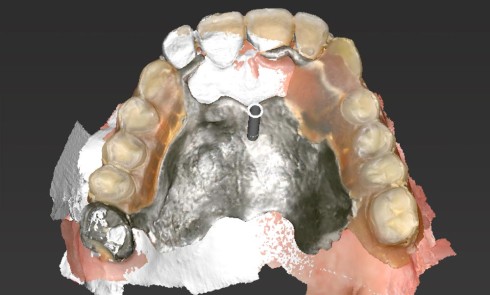L’utilisation de la zircone dans la réalisation des prothèses fixées dentaires a commencé au début des années 2000. L’avènement de la CFAO (Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur) dans les laboratoires de prothèses a, depuis, contribué à une utilisation très fréquente de ce matériau. Plus récemment, cette céramique a connu des évolutions importantes et il y a maintenant plusieurs types de zircones, avec des propriétés esthétiques et mécaniques différentes mais complémentaires [1].
Cet article propose dans un premier temps de redéfinir simplement cette « famille » de biomatériaux, ses évolutions et ses intérêts en odontologie. Chaque type de zircone sera ensuite détaillé avec ses propriétés, ses indications et sa mise en œuvre.
Enfin, une synthèse permettra de guider l’équipe clinique-laboratoire dans le choix de la bonne céramique en fonction de la situation clinique. Le zircon, ou silicate de zirconium (ZrSiO4), se présente sous forme de sable exploité dans des mines à ciel ouvert, notamment en Australie ou en Afrique du Sud.
Après extraction, des processus industriels de purification, de nettoyage et de traitements thermiques permettent de transformer le silicate de zirconium en dioxyde de zirconium (ZrO2), dont le nom commun est la zircone.
C’est ce matériau qui est utilisé en prothèse dentaire, avec un haut taux de pureté [2].
Cristallographie et propriétés mécaniques
La zircone peut avoir trois formes cristallographiques : monoclinique, tétragonale et cubique en fonction de la température. À température et pression normales, le matériau est sous forme monoclinique, présentant des propriétés mécaniques médiocres rendant son utilisation en odontologie impossible [3].
Afin de pouvoir obtenir une phase cristalline tétragonale avec les meilleures caractéristiques mécaniques, de l’oxyde d’ytrium (Y2O3) est ajouté à 3 mol en pourcentage. Le premier type de zircone à…