Si les expériences douloureuses au cabinet restent un facteur de risque établi de la peur du dentiste chez les adolescents, une étude menée par l’Université norvégienne des sciences et technologies (publiée dans BMC Oral Health) met en évidence une corrélation significative entre la peur du dentiste et les expériences défavorables vécues pendant l’enfance.
Les ACEs (adverse childhood experiences) incluent des événements tels que les abus physiques ou sexuels, le divorce parental, la violence subie ou observée, les problèmes d’alcoolisme familial ou le harcèlement scolaire.
L’étude montre que chaque type d’ACE est corrélé à une probabilité accrue de déclarer une peur dentaire. Les adolescents ayant vécu au moins une ACE présentent une probabilité 74 % plus élevée de craindre les soins dentaires.
Chez les filles, l’effet est renforcé. Il est aussi différent en fonction de l’âge : les 16–17 ans rapportent une peur dentaire plus élevée (6,6 %) que les 13–15 ans (4,5 %). La prévalence de la peur dentaire dans l’ensemble de la cohorte est estimée à 5,4 %.
Le pourcentage d’adolescents ayant vécu au moins une ACE s’élève à 54,3 %.
La position allongée sur le dos amplifie le phénomène
La corrélation observée est de type dose-réponse : plus le nombre d’expériences traumatisantes vécues est élevé, plus la probabilité de développer une anxiété dentaire augmente.
L’étude met aussi en lumière un facteur déclencheur spécifique : la position allongée sur le dos dans le fauteuil dentaire. Cette posture, associée à un sentiment de vulnérabilité et de perte de contrôle, peut réactiver des souvenirs traumatiques chez des patients ayant subi des violences physiques ou sexuelles.
Les auteurs soulignent que cette position, perçue comme intrusive ou menaçante, constitue un stimulus fréquent d’angoisse dentaire et peut expliquer certaines réactions de retrait, de rigidité ou de refus de soins.
Ces résultats rappellent « l’importance de prendre en compte le vécu psychologique dans la relation de soins ». Les auteurs encouragent les praticiens à être attentifs aux signes de détresse (respiration bloquée, crispation, refus d’allonger le dossier) et à adapter la posture ou la communication. Des gestes simples – informer avant chaque manipulation, laisser la possibilité de signaler un inconfort, proposer une position moins inclinée – peuvent réduire la tension.







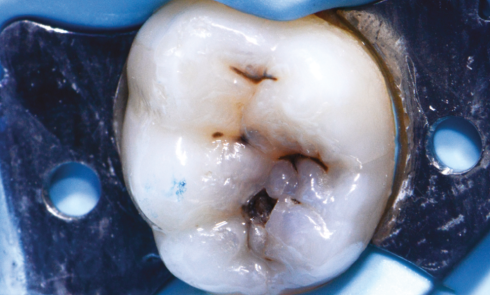






Commentaires