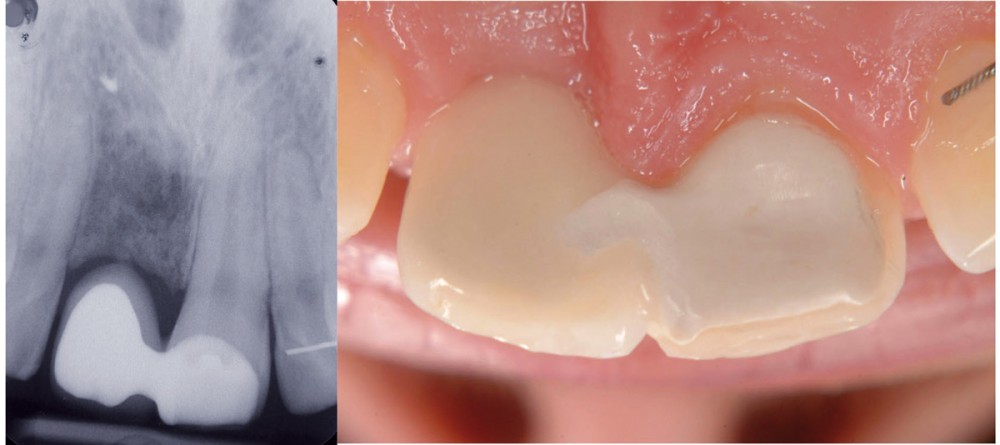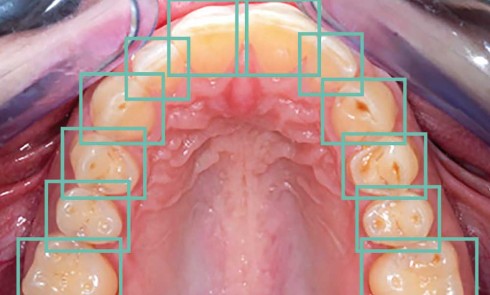Revue de la littérature
Avec l’avènement de l’implantologie et son développement rapide, il peut sembler difficile de laisser une place aux bridges collés lorsqu’il s’agit de remplacer une dent absente. Pourtant les contre-indications en implantologie (1, 2) sont assez nombreuses. Même en l’absence de ces contre-indications, il existe de nombreuses situations, notamment le remplacement de l’incisive latérale (3), où le bridge collé permet d’atteindre tous nos objectifs de traitement dans un rapport coût/bénéfice/sécurité très favorable. Par ailleurs, la conception de ces bridges collés évolue. Dans les descriptions classiques, le bridge collé est composé d’un intermédiaire et de 2 ailettes métalliques qui sont collées sur les faces linguales des 2 dents bordant l’édentement. Or, une analyse de la littérature internationale nous montre qu’il est possible, voire meilleur pour certains auteurs, de coller une seule ailette sur un pilier, solidarisée de l’intermédiaire (4). Il y a 9 ans (5), nous nous sommes intéressés à cette technique étonnante en commençant à traiter certains de nos patients en utilisant cette géométrie. Notre premier cas clinique illustrera nos propos.
Le but de cet article est de faire le point, par une revue narrative de la littérature, sur cette « nouvelle thérapeutique ». Auparavant, nous ferons un bref état des lieux sur les bridges collés traditionnels.
Les bridges collés traditionnels
Ils ont été largement décrits et étudiés depuis leur introduction au début des années 1970. Ces constructions sont nées en France grâce à la proposition princeps de Rochette en 1973 (6). Des leaders d’opinion reconnus, les Pr Degrange, Dr Samama et Dr Brabant, ont enseigné ces thérapeutiques (3, 7-9). Des synthèses ont été publiées dans des revues pour omnipraticien (10, 11) et maintenant une nouvelle génération de praticiens expérimentés s’y intéresse de près (12).
Au niveau international, et sur le…