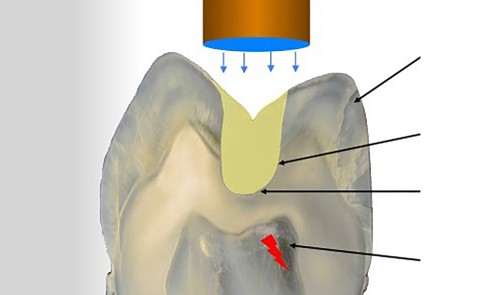Les ions fluorures constituent un élément trace non essentiel dont le rôle prophylactique contre la carie repose sur trois mécanismes complémentaires : il favorise la reminéralisation de l’émail en facilitant l’incorporation de calcium et phosphate et la formation de fluorapatite, plus résistante aux attaques acides que l’hydroxyapatite carbonatée native [1] ; il freine le métabolisme bactérien en inhibant des enzymes clés comme l’énolase et l’ATPase, ce qui réduit la production d’acides lactiques [2] ; enfin, il fragilise le biofilm en diminuant la production de polysaccharides extracellulaires et en perturbant l’adhésion bactérienne [2]. Dans la pratique, il existe deux voies d’exposition : topique (dentifrices, bains de bouche, gels, vernis appliqués directement sur les dents), et systémique (eau fluorée, sel fluoré, lait fluorés, comprimés). Toutefois, ces deux voies ne sont pas entièrement dissociables : lors du brossage, une partie du dentifrice peut être avalée, et l’eau fluorée exerce un effet topique fugace lorsqu’elle passe dans la cavité buccale.
Son efficacité dans la prévention de la carie dentaire est largement documentée dans la littérature scientifique, au point qu’un consensus institutionnel [3, 4] (soutenu par l’industrie [5]) érige les fluorures en mesure préventive de référence, parfois même présentée comme exclusive, contre la carie. Pourtant, un nombre croissant d’auteurs plaident désormais pour un usage individualisé [6, 7], de façon à rééquilibrer le rapport bénéfice-risque. Cette quasi-exclusivité de la prévention centrée sur les fluorures a conduit à marginaliser plusieurs approches alternatives, comme la supplémentation en vitamine D ou les dentifrices à l’hydroxyapatite, dont l’enseignement demeure quasi inexistant. Cela, sans même évoquer la réduction des sucres libres [8], pourtant cause principale de la carie, mais trop peu mise en avant dans…