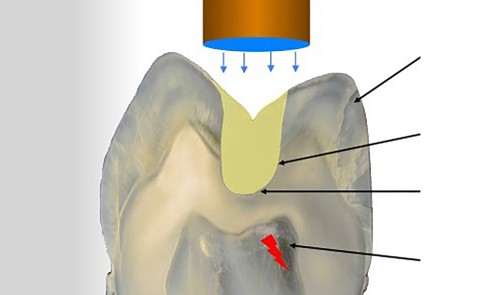L’expérience du praticien : un apprentissage sur plusieurs décennies
Après plus de trente ans de pratique clinique, une certitude s’impose à moi : la biologie n’est pas totalement prédictible. Même en respectant scrupuleusement les recommandations basées sur les preuves scientifiques et en évitant les compromis thérapeutiques, les suites postopératoires, la variabilité de la cicatrisation et le vieillissement tissulaire rappellent que le succès à long terme n’est jamais garanti.
Les études longitudinales montrent que la longévité des restaurations est multifactorielle :
- facteurs liés à la dent : localisation plus ou moins antérieure de la dent, taille plus ou moins volumineuse de la restauration, profondeur des marges cervicales plus ou moins importante, vitalité ou dent dépulpée ;
- facteurs liés au patient : hygiène bucco-dentaire, santé parodontale, tabac, alcool, risque carieux, habitudes alimentaires, tics et parafonctions , statut socio-économique… [2] ;
- facteurs liés au praticien : maitrise du protocole clinique, choix du matériau, choix de l’assemblage, Isolation opératoire, expérience, mais aussi exercice individuel ou en groupe… [3].
Une revue systématique récente rapporte que les restaurations composites postérieures présentent par exemple des taux d’échec annuels très variables (AFR) de 0,08 à 6,3 %, avec des taux de survie cumulés allant de 23 à 97,7 % selon les cohortes étudiées [2].
Toutes nos restaurations vieillissent. Tous nos patients vieillissent. Ce vieillissement doit être anticipé lors de nos choix thérapeutiques.
Nous jouons donc un rôle important par notre capacité à réaliser les bons choix thérapeutiques selon la situation clinique, à choisir les matériaux à utiliser de manière éclairée, par la rigueur de nos gestes opératoires et notre capacité à assurer une maintenance régulière.
Les leçons du recul clinique
L’expérience clinique m’a…